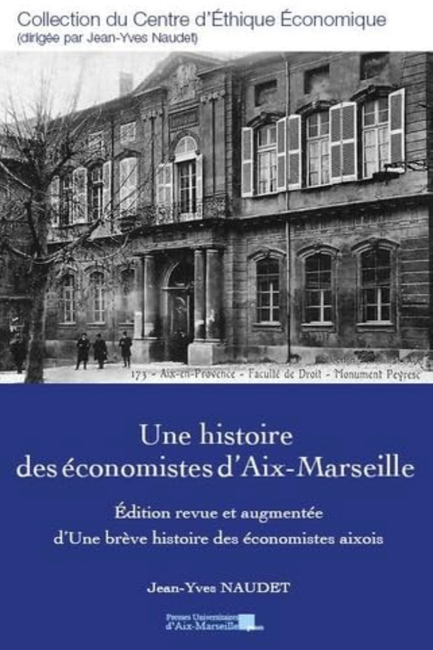
REFLEXION
20 mai 2024
Une histoire des économistes d’Aix-Marseille : quand les petites histoires nous racontent une plus grande
L’ambition du livre de Jean-Yves Naudet est simple : « raconter l’histoire des économistes d’Aix comme de Marseille », de 1800 à 1970.
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.